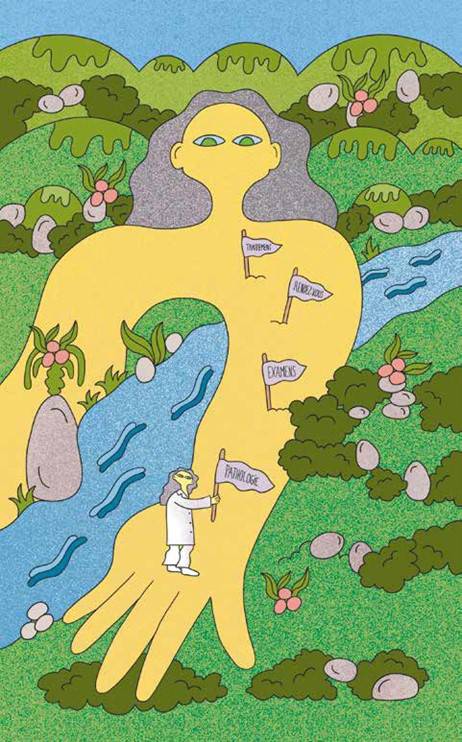De l’autre côté du stéthoscope : ces soignants devenus patients
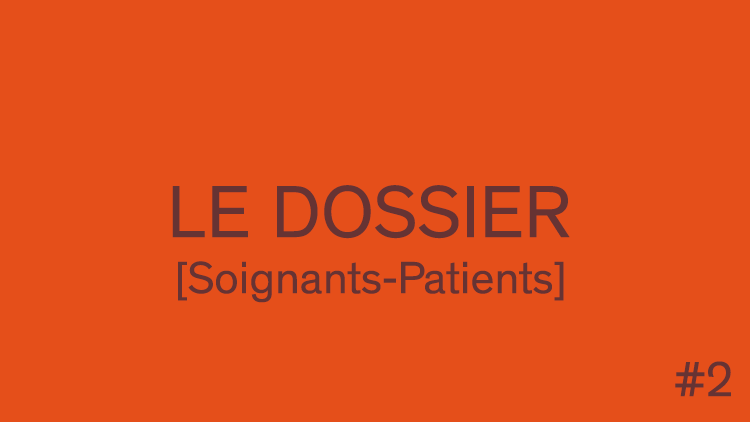
«La maladie chez les soignants n’est pas une thématique couramment abordée ; ni par le grand public, ni chez les professionnels de la santé eux-mêmes.»
Le 12 novembre, très exactement. Ce jour-là, un simple test PCR fait basculer sa vie. « J’ai d’abord eu les symptômes classiques du Covid: fièvre, toux, fatigue, perte du goût et de l’odorat. Et puis, la fatigue écrasante a persisté.» À l’époque, elle dort près de 20 heures sur 24. Voyant que son exténuation ne diminue pas après deux mois d’arrêt maladie, elle se résout à consulter.
À la suite d’une batterie d’examens, une première analyse pneumologique révèle une hyperventilation. «C’était comme si mon cerveau avait disjoncté et ne savait plus me faire respirer normalement. J’avais l’impression d’être amputée d’un poumon.» Un autre examen établit un trouble de l’attention modéré à sévère, d’où ses difficultés à se concentrer.
Sans savoir que la suite des évènements deviendrait pour elle un véritable parcours du combattant, Gloria raconte que « quelques semaines après ces examens, on partait encore du principe que cela durerait peu de temps et qu’il fallait essayer d’aller de l’avant». Raison pour laquelle elle opte alors pour une reprise thérapeutique à 20% dans son unité de soins. «En regardant mes collègues travailler, je me rendais compte à quel point les infirmières sont multitâches et doivent être capables de se concentrer sur beaucoup de choses en même temps.» Pour Gloria, «c’était devenu impossible. Je perdais le fil dans les soins, j’étais devenue extrêmement monotâche».
L’expérience n’est pas concluante mais elle ne baisse pas les bras. En novembre 2022, à sa demande, elle fait une seconde tentative de reprise thérapeutique, poussée par le fait qu’elle atteint bientôt les 730 jours maximums de congé maladie accordés par son employeur. Pour cette nouvelle reprise, elle intègre le Service de médecine ambulatoire à 10%. Un rythme moins soutenu et qui offre l’avantage au personnel soignant de s’occuper d’un patient après l’autre. « Au bout de trois mois, je me suis rendu compte là aussi qu’il serait impossible de revenir à un taux de travail plus élevé.» Le matin, elle dit se réveiller épuisée, quel que soit le nombre d’heures de sommeil obtenues la nuit. «L’après-midi, j’étais obligée de dormir.»
Le couperet tombe enfin le 19 novembre 2022: Gloria est en fin de droits. Heureusement, cette infirmière d’aujourd’hui 48 ans est déclarée en maladie professionnelle du fait qu’elle a attrapé le Covid sur son lieu de travail. Son assurance lui paye donc des indemnités. Aujourd’hui, après dix années passées dans son service, elle fait les démarches pour devenir bénéficiaire de l’assurance invalidité. «C’est l’inconnu total», soupire-t-elle à mesure que la place du marché s’emplit toujours plus.
La maladie comme « traversée »
Depuis plus de deux ans maintenant, Gloria fait partie de ces soignants devenus malades. Combien sont-ils, comme elle, à lutter contre une affection à long terme? De quoi souffrent-ils le plus? «Nous ne disposons pas de ces chiffres», nous répond l’Office fédéral de la statistique (OFS). Un manque d’information que l’on retrouve aussi dans la littérature scientifique. Et pour cause, la maladie chez les soignants n’est pas une thématique couramment abordée; ni par le grand public, ni chez les professionnels de la santé eux-mêmes. «Nous nous définissons en vainquant la maladie, pas en y succombant», déclarait, dans une tribune du New York Times, l’autrice et médecin américaine Danielle Ofri. Et d’ajouter que «même si nous éprouvons de l’empathie pour nos patients, établir une démarcation inconsciente entre «nous» et «eux» est nécessaire pour protéger notre noyau intérieur [de soignant]».
Il arrive toutefois, comme cela fut le cas pour Gloria, que cette démarcation soit transgressée. Que les soignants, en tombant malades, fassent l’expérience de passer du «nous» (soignants) au «eux» (soignés). Dans son livre Quand les médecins deviennent patients (2007), le psychiatre américain Robert Klitzman raconte à quel point sa propre dépression, aussi difficile fut-elle à avouer à ses confrères, lui a par exemple permis de « comprendre l’embarras et la stigmatisation parfois vécue par les patients». Il affirme: «Traverser la frontière de médecin à patient m’a appris à quel point j’étais ignorant.»
Cette expérience semble avoir été similaire pour Denis Hochstrasser, ancien vice-recteur de l’Université de Genève et chef du Département de médecine génétique et de laboratoire des HUG. En 2017, après une carrière académique plus que remarquable, il découvre qu’il est atteint de la maladie de Parkinson, ce qui l’oblige à prendre une retraite anticipée à l’âge de 64 ans. «C’est une maladie neurodégénérative, qui n’ira pas vers le mieux, mais dont le rythme d’évolution n’est pas déterminé d’avance», nous explique-t-il dans la cuisine d’une charmante maison située sur la rive gauche genevoise. Il a devant lui quelques notes, il tient à ce que le récit soit exact et complet.
Pour lui, tout a commencé par des tremblements de la main gauche. Les clignements de ses yeux se faisaient plus rares, son visage était moins souriant et ses niveaux d’énergie beaucoup plus bas que d’habitude. À l’époque, une analyse de sa flore intestinale révélait une absence totale de Prevotellaceae, une famille de microbes qui, en taux inférieur à 6 % dans les intestins, élève à 85% la probabilité d’être atteint de Parkinson. « C’est une maladie qui est très liée à la malbouffe et au stress, une maladie qui touche principalement les pays industrialisés», explique le professeur.
«Il arrive (…) que les soignants, en tombant malades, fassent l’expérience de passer du “nous” (soignants) au “eux” (soignés).»
Pour lui comme pour Gloria, la maladie a aujourd’hui déjà donné lieu à un important changement de statut. Comme le résumait l’infir- mière de son côté: «Il a fallu que je fasse le deuil de la personne que j’étais avant, au niveau personnel comme au niveau professionnel.» Et d’ajouter que « je ne suis plus Gloria Castro l’infirmière, je suis Gloria Castro la malade de Covid long». Un passage de soignante à soignée qui, comme l’explique Denis Hochstrasser, peut aussi avoir des avantages: « En tant que médecin spécialisé, j’ai sans doute su poser des questions plus ciblées et comprendre plus facilement les réponses sur la pathologie et les traitements. Ce qui m’a permis de rester à flot au fil des rendez-vous et des examens.» Car comme le conclut le professeur: «Beaucoup de gens subissent les choses dans leur parcours médical.»
Une leçon d’empathie
Ce brouillard que ressentent les patients peut parfois être lié au manque de temps ou d’empathie de la part des professionnels de la santé, comme l’explique Gloria: «À l’école d’infirmière, on apprend qu’il y a le savoir-faire et le savoir-être avec le patient. Quand je suis passée de l’autre côté de la barrière, si je puis dire, je me suis rendu compte à quel point ce deuxième élément pouvait être lacunaire chez certains professionnels.»
Comme l’analyse Christine Clavien, philosophe des sciences et de la morale à l’université de Genève et membre de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine, « certes, on attend de l’empathie de la part des médecins, mais la grande sélection dans les études, qui se fait surtout au terme de la première année, ne se fait pas sur cette base-là mais sur des compétences plus facilement objectivables». Et la professeure de préciser que « l’empathie est toutefois enseignée plus tard dans le cursus, à travers des cours d’éthique mais surtout lors des stages en milieu clinique, où les étudiants entrent en contact avec la souffrance». Pour elle, «c’est là, auprès des patients, que les élèves apprennent le plus, et la qualité de la supervision est cruciale lors de ces phases d’immersion».
Enfin, nous explique la philosophe, si l’empathie est une compétence que l’on peut entraîner, «un professionnel de la santé qui n’a pas vécu des choses similaires à ce que vit le patient aura plus de difficulté à le comprendre pleinement». Pour elle, le fait que des spécialisations comme gynécologue ou sage-femme comptent essentiellement des femmes, montre qu’«une dose de vécu commun est cruciale pour la capacité à soigner des patients». La philosophe prend aussi l’exemple de la médecine de dysphorie de genre (le sentiment d’inadéquation entre le sexe assigné à la naissance et l’identité de genre): « Les meilleurs médecins qui s’intéressent à la question ont eux-mêmes un vécu personnel ou à travers un proche de la question et comprennent vraiment les problèmes qui y sont rattachés. Ils seront aussi plus ouverts à se perfectionner avec des formations complémentaires par exemple, pour devenir encore meilleurs dans le domaine.»
La description colle bien au profil de Sophie qui, par pudeur, n’a pas souhaité que nous diffusions ici son vrai prénom. Aujourd’hui étudiante en deuxième année de médecine à l’Université de Genève, cette jeune femme de 22 ans n’a pas choisi ce parcours pour rien. Penchée sur son thé noir fumant, accompagné d’un biscuit qui n’a pas été déballé, elle revient avec nous sur la « boucle infernale » de l’anorexie qui a chamboulé sa vie à l’aube de ses 14 ans. «J’avais perdu du poids de manière involontaire pendant un été et je me souviens avoir compris que je pouvais contrôler ça de manière volontaire.»
«Une dose de vécu commun est cruciale pour la capacité à soigner des patients.»
Quelques semaines plus tard, elle commence à restreindre drastiquement son alimentation. Rapidement, son poids chute de manière vertigineuse. Ses parents s’inquiètent, mais cela n’y fait rien. « Il a fallu que des touffes de cheveux me restent dans la main en me coiffant un matin pour me rendre compte que c’était grave.» Une prise de conscience malgré laquelle elle mettra plus de quatre ans à retrouver un équilibre. «Je suis aussi passée par des phases boulimiques et une hospitalisation», relate Sophie, les mains enveloppant sa tasse.
De son expérience de patiente, elle se souvient: «C’était très important pour moi quand j’avais le sentiment d’en apprendre aux médecins sur ma maladie grâce à mon propre vécu. C’est dans ces moments que j’avais l’impression de faire les plus grandes avancées.» Gloria Castro rapporte un sentiment similaire avec son Covid long: «Les mystères qui entouraient la maladie au moment où je l’ai attrapée rendaient les médecins plus à même d’apprendre en même temps que nous. C’était intéressant car les patients étaient considérés comme des experts à leur niveau.» Et de préciser: «Experts par expérience et non par expertise.»
Penser en réseau
«C’est vrai que les patients connaissent beaucoup de choses», confirme Denis Hochstrasser, lui qui incarne sans doute le mieux le savoir théorique. Après des études de médecine à Genève et aux États-Unis, il a dirigé le Service de médecine de laboratoire aux HUG, puis le Département de médecine génétique. Il a également été chercheur en neurogénétique et biochimie à Washington, et a cofondé l’Institut suisse de bio-informatique et le Centre suisse de toxicologie humaine appliquée. Mine d’or dans un certain contexte, ce savoir peut aussi s’avérer être un fardeau: « Il en savait tellement sur la maladie et son impact avant de l’attraper que cela lui a certainement causé beaucoup plus de terreur au moment du diagnostic, comparé à nous qui n’en connaissions rien», raconte sa fille Sandrine.
Commence donc un long travail de désapprentissage, ou plutôt, dans les termes de Denis lui-même, de «réapprentissage des choses essentielles». À savoir: «Vivre le moment présent», mais aussi et surtout, «profiter de mes proches». Père de trois filles et grand-père de sept petits-enfants, il explique qu’il n’avait «jamais réalisé le rôle capital de la famille dans la perception des choses» d’une personne malade. De son côté, Sandrine raconte elle aussi avoir été « fortement touchée » au moment d’apprendre que son père était malade: « J’étais moi-même enceinte de mon premier enfant. C’est une temporalité étrange, au moment où on va donner la vie, que d’apprendre que l’un de ses parents est atteint dans sa santé.»
Pour Françoise, la mère de Sophie, l’inverse fut tout aussi difficile: «C’est terriblement douloureux d’apprendre que son enfant est malade, d’une part car on ne peut s’empêcher de se sentir responsable, mais aussi parce que l’on veut tout faire pour leur ôter leur souffrance.» Et d’ajouter, la voix chevrotante au bout du fil: «On a traversé l’épreuve de la maladie en même temps que [Sophie]. Son parcours pour aller mieux était aussi le nôtre.»
Et c’est peu dire, à en croire la fille de Denis Hochstrasser, que les autres ont aussi joué un rôle essentiel dans sa maladie: «Une fois la période d’effroi du diagnostic passée, c’était incroyable de voir à quel point mes deux parents se sont serré les coudes et comment ma mère a été un élan et une force pour lui.» Et de poursuivre: «C’est fou comme la médecine, avec ses diagnostics froids et parfois irrévocables, peut avoir tendance à condamner les personnes tandis que les proches, avec leur espoir, les font avancer.»
Pour Gloria Castro, le constat est le même: « La famille et les amis proches sont de véritables ressources pour moi du fait qu’il faut parfois s’adapter aux rythmes que m’impose la maladie. » Pour Véronique, l’une de ses amies de longue date, «il faut veiller à toujours garder un lien, même si on se voit moins souvent, car la maladie peut devenir un cercle vicieux dans lequel vous avez moins d’énergie pour participer aux évènements sociaux et que par conséquent les personnes vous sollicitent moins et ainsi de suite». Elle décrit Gloria comme «quelqu’un d’indépendant, qui a toujours eu l’habitude de se débrouiller seule », et relève, voyant le verre à moitié plein, que «depuis sa maladie, elle a tendance à chercher davantage d’aide et à s’ouvrir plus».
Au-delà de ces changements, Gloria explique que la maladie a également bouleversé sa propre vision de ce que devraient être les soins: «Je suis aujourd’hui plus que convaincue de l’importance d’une approche biopsychosociale», c’est-à-dire une approche des soins dans laquelle les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux sont considérés comme essentiels et inséparables dans le maintien de la santé, précise-t-elle.
Aujourd’hui, l’ancienne infirmière fait partie d’une association de quatre ex-consœurs qui sont dans la même situation. « Ce n’est pas grand-chose mais c’est un moyen d’être plus fortes et plus solidaires face aux démarches administratives, médicales ou professionnelles.» Depuis peu, elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux, dans des groupes consacrés spécifiquement à l’échange entre internautes autour du Covid long: «C’est un gros soulagement de sentir que l’on n’est pas seule et que l’on peut échanger avec des personnes auprès de qui l’on ne doit pas sans cesse se justifier dans sa condition. » Car, « mieux encore que les proches qui vous soutiennent, ceux qui vous comprennent vraiment dans la maladie sont vos paires», indique Gloria.
A contrario, l’usage des réseaux sociaux peut aussi avoir un effet plus néfaste dans la maladie. Raison pour laquelle Sophie a décidé depuis plusieurs années de se retirer de toutes les plateformes sociales en ligne. « À l’époque où je sentais que je sortais enfin de l’anorexie, c’était source d’une trop grande angoisse que d’être en permanence confrontée à des standards de beauté inaccessibles et de m’y comparer sans cesse. » Elle dit s’en tenir aujourd’hui aux «vraies gens» qui l’entourent, c’est-à-dire à «quelques très bons amis et à ma famille» avec qui elle se sent à l’aise d’échanger sur son vécu et son intimité.
«Prendre soin du système»
Aujourd’hui, la jeune étudiante ignore encore la spécialisation vers laquelle elle souhaite s’orienter. Pour l’instant, elle dit être «en train de digérer ces deux premières années particulièrement intenses». La première, notamment, «a été extrêmement difficile et je sentais qu’avec le stress, l’envie de me ruer sur de la nourriture était là». Toujours déterminée à ne pas «glisser», comme elle le dit, elle voit une psychologue régulièrement et essaye de se consacrer quelques minutes par jour à des exercices de méditation ou de respiration. Une démarche personnelle malgré laquelle la vie d’étudiante en médecine ne manque pas de la mettre à rude épreuve. Investissement en temps et en énergie considérable, bachotage intense, Sophie ironise : « Il y a des similitudes avec les troubles alimentaires, à savoir que l’on ingère une énorme quantité d’information, dont on assimile qu’une partie, avant de tout régurgiter en examens. » Faisant écho aux propos de la philosophe Christine Clavien, elle ajoute: «Je pense qu’on a vite tendance de cette manière à oublier que ce sont des gens que l’on devra soigner au final, ce qui demande de l’empathie. Ce n’est pas forcément ce que l’on apprend le mieux en médecine.» Mais elle garde bon espoir que «demain, on saura faire et être différemment dans la médecine conventionnelle», assurée par sa propre expérience que « guérir, ce n’est pas juste prendre des médicaments, c’est tellement plus que ça».
Pour Gloria Castro, ce «tellement plus», c’est aussi «prendre soin du système de santé lui-même». Comme elle le rapporte, «aujourd’hui par exemple aux HUG, une personne sur deux estime que son travail affecte sa santé», faisant ainsi référence à un sondage effectué en début d’année, après une période d’intense activité au sein de l’hôpital. Vagues de Covid répétées, grippe, bronchiolite: « Nous avons beaucoup applaudi les soignants et les soignantes mais, dans les faits, les conditions-cadres du métier demeurent difficiles.»
Soigner les malades, soigner les soignants: Denis Hochstrasser pose un maillon supplémentaire à la chaîne, inspiré par sa propre maladie : « Il a été démontré que la prévalence de la maladie de Parkinson est plus élevée dans les villages viticoles, de par l’usage de certains pesticides sur la vigne. » Un constat qui n’est pas sans renvoyer à une étude de 2022 (Yan et al.) ayant révélé que les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin présentaient une quantité plus élevée de microplastiques dans les selles que les personnes saines. Nous pourrions continuer longtemps, par exemple en citant la pléthore d’études qui démontrent aussi les liens entre pollution de l’air et cancers des divers organes respiratoires, asthme aggravé ou bronchopneumonies obstructives chroniques.
Au vu de cette longue liste de corrélations, de plus en plus de professionnels de la santé cherchent à créer des ponts entre santé et environnement, à l’instar du mouvement Doctors for Extinction Rebellion, la branche médicale du mouvement de désobéissance civile qui regroupe une petite centaine de médecins de Suisse romande. Dans un communiqué, le groupe soutient que « le changement climatique est la plus grande menace pour la santé globale au 21e siècle. En tant que professionnels de la santé, nous sommes inquiets pour la santé de nos patients et de la population, d’ici et d’ailleurs».
Pour Sophie, «en creusant un peu autour de certaines maladies, comme l’anorexie, on se rend compte que les personnes affectées sont prises dans tellement de forces qui les dépassent. Je me souviens, pendant ma propre maladie, de l’injonction si forte à consommer, mais en même temps à être mince et en parfaite santé». Pour le climat, « c’est un peu la même chose, on pousse aux gestes individuels alors qu’on nous bombarde de nouveaux produits en permanence ». Ainsi, voir certains médecins se mobiliser pour «tacler le problème à la source» donne à Sophie «de l’espoir pour l’avenir de la profession».
Garder espoir
D’un air songeur, Denis Hochstrasser ajoute que l’espoir, justement, «fait sans doute aussi partie intégrale du traitement. C’est quelque chose auquel le patient doit toujours pouvoir se raccrocher». Il s’appuie là encore sur sa propre expérience: «À l’époque de mon diagnostic et aujourd’hui encore, Parkinson est considéré comme une maladie neurologique et sans issue, mais en creusant dans la littérature scientifique, on se rend compte qu’elle atteint aussi les neurones digestifs et qu’il y a sans doute beaucoup à explorer en termes de régimes alimentaires pour agir sur son évolution.» C’est d’ailleurs ce que Denis a essayé. Résultat: «Après trois mois d’une alimentation sans sucre et riche en légumes crus et cuits, la diversité de mon microbiote avait doublé.» En termes d’impact que cela a eu sur sa maladie, «elle se développe très lentement, mais on ne peut pas affirmer avec certitude que cela est dû à mes changements alimentaires».
Ce qui est certain pour le professeur, c’est qu’«en tant que patient, on a besoin de s’ouvrir aussi à des choses que la médecine conventionnelle, parce qu’elle n’en connaît pas l’efficacité, ne peut pas nous recommander». Il ajoute: «Même si je ne peux pas faire abstraction des choses que la médecine conventionnelle a de bénéfique, les médecines complémentaires ont pris pour moi une importance qu’elles n’avaient pas avant que je ne devienne patient.» Si l’équilibre entre médecines conventionnelle et alternative peut être «délicat à maintenir», comme l’indique Sophie de son côté, «je peux comprendre qu’en tant que patient on ait envie d’essayer des choses, ne serait-ce que pour ne pas se sentir condamné».
Pour Gloria Castro, le dilemme est plus vite réglé: « Le Covid long est tellement récent qu’il n’y a même pas de véritable piste à suivre, qu’elle soit conventionnelle ou alternative.» Pour elle, l’espoir réside donc simplement dans le fait de «retrouver un jour le chemin du travail». Malgré «l’épée de Damoclès» qui plane au-dessus de sa tête, elle espère aussi pouvoir «continuer de porter le débat autour du Covid long sur la place politique». Elle a d’ailleurs récemment décidé de se présenter aux prochaines élections pour le Conseil national sur la liste de l’Union populaire. « Même si je ne suis pas certaine de pouvoir faire une campagne hors pair», tempère-t-elle.
De son côté, Denis compte bien profiter de chaque instant. «Il a davantage de disponibilité mentale depuis sa maladie», note sa fille Sandrine. «À l’époque, c’était l’archétype de l’homme qui, passionné par ce qu’il faisait, travaillait trop, au détriment de sa santé. Aujourd’hui, c’est tout le contraire.» À l’arrivée de l’été, son jardin luxuriant et vert n’attend plus que lui.
Pour Sophie, maintenant que ses examens et travaux pratiques de l’année sont derrière elle, place aux longs après-midis au bord du Rhône ou sur les rives du lac. Mais comme pour dire que la maladie n’est jamais bien loin, elle confie que sa famille a «appris récemment que [son] père faisait de l’hypertension». Pour Françoise, sa mère, «il va falloir veiller à son alimentation et à ce qu’il reprenne une activité physique régulière». Au téléphone, elle s’amuse de voir que «pendant un moment, il fallait veiller à ce que [Sophie] mange davantage. Maintenant, c’est à mon mari de manger moins de certaines choses. On a vraiment l’impression de faire le pendule». C’est peu dire que l’image aurait donné du fil à retordre aux plus grands penseurs et penseuses de la santé: Friedrich Nietzsche, Georges Canguilhem ou plus récemment Barbara Stiegler, pour qui la maladie n’est ni plus ni moins que « l’autre de la santé dans la santé», deux termes qui « se constituent l’un par rapport à l’autre, dans le mouvement même de leur tension».