Quand le pouvoir enfreint le savoir. Réflexions sur le pouvoir médical de prescrire
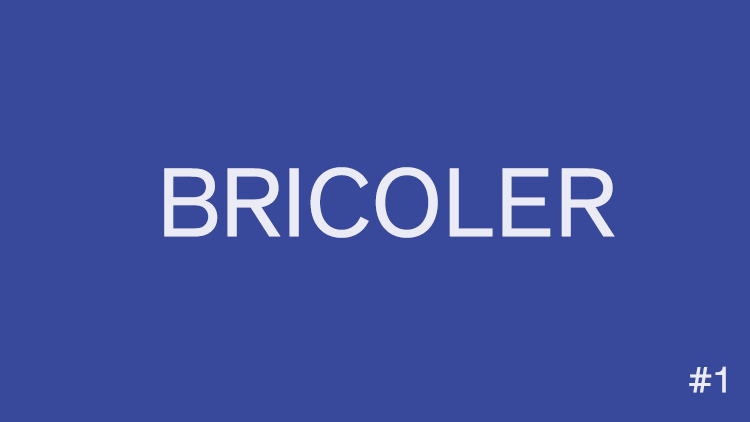
18 heures, chemin de la Mousse 46, ça joue? Quelques minutes plus tard, un numéro inconnu s’affiche sur mon écran.
-18 heures ok. Tu veux quoi?
- LSD.
- On n’a pas.
- Ritalin?
- Oui.
- Ecstasy?
-Oui.
À 18 heures, une Smart de location noire se gare devant le chemin de la Mousse 46. Au volant, un jeune homme apprêté d’un pantalon en lin beige et d’une chemise blanche repassée. J’ouvre la portière et m’installe à ses côtés. La voiture sent le neuf. Il roule quelques mètres et se parque sur une place bleue. On discute un peu. Il me dit qu’il est étudiant en droit, qu’avant le Covid, il travaillait dans un bar et que lorsque le bar a fermé, il a postulé pour Service Provision.
- Je m’y plais. Les horaires sont flexibles, la clientèle respectueuse. Chaque quinze jours, je reçois une carte prépayée avec un nouveau numéro de téléphone.
On passe en revue sa marchandise. L’étudiant en droit me vante la qualité de sa C (cocaïne) et affirme avoir reçu d’excellents retours. Il sort ensuite des pilules d’ecstasy roses et dit:
- Celles-ci sont puissantes.
Je lui en prends cinq à 8 CHF et, comme s’il se souciait de mon bien-être, il précise:
- Si tu enchaînes les soirées, mon conseil c’est de faire une pause d’au moins six heures entre les prises. Tu peux combiner avec de la C ou de la Kéta (Kétamine) mais en ajouter deux de celles-ci à la suite, c’est franchement risqué, même pour les habitués.
Lorsque je me renseigne sur la qualité de sa MDMA, il émet un léger pincement de lèvres et dit:
- La semaine prochaine, on aura mieux.
Il retire ensuite de son sac à dos une trousse d’écolier Titeuf qui comprend des drogues licites sous ordonnance, Xanax, Temesta, Seroquel, Ritalin, Concerta, Stilnox, Tramal et plus encore.
- C’est 10 balles la pastille, mais si t’en prends plusieurs, je peux te faire un discount.
À nouveau, il me fait part de ses considérations. Il me dit que, selon lui, les effets de la Quétiapine, le principe actif du Seroquel, outre faire grossir, n’en valent pas la chandelle et qui, si mon objectif c’est dormir, mieux vaut continuer avec les benzos (benzodiazépines), les somnifères classiques ou prendre de la Kétamine. Il me dit que le Tramal, c’est de l’héro (héroïne) sans les plaisirs de l’héro et que le Concerta, c’est grosso modo de la Ritalin (méthylphenidate) à durée d’action prolongée, mais que si je souhaite obtenir le rush de la Ritalin avec le Concerta, il suffit que je dissolve la couverture sous la langue, que je coupe la pilule en deux et que je sniffe la partie blanche.
- Donc si tu hésites entre la courte durée d’action de la Ritalin et la longue durée d’action du Concerta, je te conseille vivement le Concerta, parce que ça te fait un «deux en un».
Je lui demande s’il ne vend pas d’autres types d’amphétamines hormis le méthylphénidate. Il me répond que non, expire et, comme s’il lisait dans mes pensées, ajoute:
- Si tu veux mon avis, pour te concentrer, il n’y a pas mieux que la C. C’est ce que je prends pour mes exas. Non, parce qu’avec ces merdes, dit-il en se référant aux stimulants à base d’amphétamine et de méthylphenidate, les descentes sont quand même méga violentes. Alors qu’avec la C, on reste dans le naturel.
Je lui prends de la Ritalin, une tablette de Stilnox et du Xanax. En emballant ma commande, il me demande si j’ai déjà essayé la beuh pour me concentrer.
- J’ai pas mal de clients qui alternent entre weed et Ritalin pour travailler. Le secret, apparemment, c’est d’en fumer peu.
Un petit quart d’heure de conversation plus tard, le futur juriste m’annonce qu’il doit filer. Il a son prochain client dans trente minutes et il doit encore passer chercher des saucisses au Migrolino. Je le remercie et lui souhaite une bonne soirée. J’en ai eu pour 150 CHF, soit le prix que mon psychiatre facture à mon assurance maladie pour quarante-cinq minutes de consultation.
Mon psychiatre me fournit lui aussi des drogues, mais contrairement au dealer de Service Provision, il ne semble pas être informé des alternatives et des effets nuancés de ce qu’il me prescrit. Ses connaissances se limitent à une partie restreinte des substances psychoactives disponibles sur le marché qui émanent de surcroît d’une littérature souvent influencée, voire subventionnée, par l’industrie. Et puis, même si mon psychiatre maîtrisait, admettons, les subtilités entre sniffer de la cocaïne, fumer du cannabis et ingurgiter des amphétamines, la nature de nos échanges nous empêcherait d’en
«Dans le meilleur des mondes, les dealers seraient des médecins et les médecins ne seraient plus des dealers.»
discuter ouvertement. Comme tous les médecins, mon psychiatre assure une responsabilité civile à l’égard de son patient et de la société. Afin qu’il puisse prescrire de la drogue en bonne conscience, son patient à tout intérêt à jouer le malade plutôt que de lui dire la vérité, à savoir: si je veux de la drogue, c’est parce que j’aime ça.
Les hommes se droguent pourtant depuis la nuit des temps et pas uniquement à des fins médicales. Se droguer fait partie de la nature humaine. Sa stigmatisation en revanche est récente: 1916 marque la première loi prohibitionniste et raciste visant l’interdiction de l’opium et 1971, notre entrée officielle dans la guerre contre les drogues. Depuis lors, aimer la drogue est caduc et seul le malade est excusé de se droguer. Les autres, ceux qui prennent plaisir à altérer leurs consciences, sont criminalisés et plongés dans la honte. Il en résulte que les médecins, ceux qui sont censés savoir et «contrôler» l’accès du peuple aux drogues, se retrouvent coupés de la réalité du terrain. Leur pouvoir et le dispositif puritain qui le maintient dissuadent le savoir de circuler.
Alors qu’avec les dealers illégaux, la transmission des connaissances et des expériences n’est pas obscurcie. Des tuyaux sont échangés, des récits sont partagés et, bien que les substances illégales proposées ne soient pas dénuées de risques, car produites et commercialisées clandestinement, le consommateur se montre généralement plus responsable et averti que lorsqu’il s’intoxique avec la bénédiction du corps médical. S’il se plante, ce sera de sa faute, et non celle du médecin ou des méchantes compagnies pharmaceutiques. La décision de se droguer lui incombe.
Je ne vais pas vous mentir, il m’aurait plu que le dealer de Service Provision soit un étudiant en médecine plutôt qu’un étudiant en droit. Oui, dans le meilleur des mondes, les dealers seraient des médecins et les médecins ne seraient plus des dealers. Les drogues seraient légalisées, ce qui responsabiliserait les consommateurs. On ne pourra plus dire: « Si j’ai sombré dans l’héro, c’est la faute des médecins. » Ou encore : « Si la croissance de mon enfant a été interrompue par une prescription quotidienne d’amphétamine, c’est de la faute des médecins. Ce sont eux qui lui ont diagnostiqué un trouble du déficit de l’attention qui n’en était pas un!» Oui, dans le meilleur des mondes, on serait responsable de ce que l’on fait de son corps. Quant aux médecins, ils agiraient en conseillers. On les solliciterait pour leurs lumières et leurs savoirs et non plus pour leurs pouvoirs.
