Restituer la dîme pour décoloniser les sciences médicales
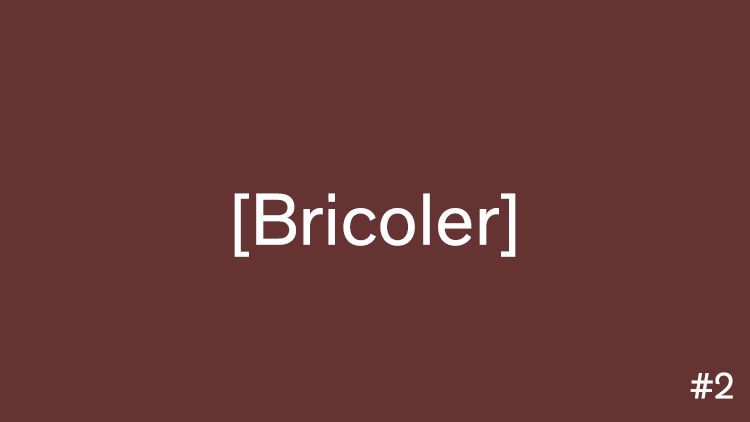
Autour d’une table en vieux bois, acteurs et experts du monde médical échangent. Le personnel soignant, apprends-je, est non seulement épuisé, mais il y croit de moins en moins. Un nombre croissant d’infirmiers et d’infirmières désertent la profession pour s’adonner à des thérapies aux visées plus holistiques et spirituelles. Quant aux médecins, c’est l’abattement général. Les espoirs qu’ils ont placés dans les sciences médicales au début de leurs carrières se sont effondrés d’un coup. Oui, ils ont été dupes. Ils y ont cru, ils se sont imaginés maîtres d’un navire qui réagit désormais autrement que prévu. La coque prend l’eau, l’équipage est en burnout et même le capitaine commence à douter de ses facultés. Un mal-être diffus et immatériel se propage au sein de la profession. Il convient donc de réfléchir, de réviser ses postulats, de s’horizontaliser…
Avec un brin d’humour, l’écrivain suisse Christophe Gallaz déclare que la vraie solution se trouve dans le LSD. Nous rigolons. Nous rigolons de bon cœur mais nous rigolons aussi jaune. Car il n’est en effet pas exclu que ce soit là-bas, dans ces contrées mystiques de la psyché humaine, que se loge une forme de rédemption. Bruno Latour et ses «modes d’existences» sont maintes fois évoqués, tout comme la nécessité urgente de s’ouvrir, en dépit de leurs manques de fondements scientifiques, à de nouveaux paradigmes thérapeutiques. Si les gens souhaitent engloutir le placenta de leurs nouveau-nés, pourquoi les en dissuader? Idem pour ceux qui traitent leurs cancers avec des fleurs de Bach. Ces pratiques ne sont plus à radier ni à brûler, mais à respecter, voire à intégrer.
Au loin, la colère de Zeus gronde. Vents et éclairs réverbèrent sur nos visages livides. Arrive la grêle qui frappe si fort qu’il faut élever le ton pour se faire entendre. Cette manifestation météorologique, me dis-je alors, ne peut qu’être un signe. Le signe que la médecine traverse effectivement un mauvais quart d’heure. Serait-ce le motif de la création de cette revue de santé intégrative ? Intégratif vient d’integrare qui signifie en latin réparer, renouveler, recommencer et remettre en état. Cette revue ambitionnerait-elle de réparer la médecine? Et le cas échéant, de la réparer de quoi? De son hubris?
Le débat continue. On évoque la parution d’un article dans le New York Times qui stipule que le taux de suicide des médecins américains aurait surpassé celui des membres actifs de l’armée. La vocation de soigner persisterait, mais ce serait l’institution, le système dans lequel cette vocation est mise en œuvre, qui déraillerait et alimenterait l’épuisement moral du personnel médical.
Ce tsunami de constats pessimistes me laisse perplexe, car dans les faits, la médecine semble se porter à merveille. N’a-t-elle pas accompli des progrès spectaculaires ces dernières décennies ? Prenons ne serait-ce que l’oncologie pédiatrique. À la fin des années 1970, un enfant atteint d’une leucémie avait environ 20% de chances de survivre. Aujourd’hui, ce taux est monté à 80 %. Des avancées similaires sont observables dans toutes les branches de la médecine, à l’exception d’une : celle de la psychiatrie, cette spécialisation médicale qui chaperonne ce que nous désignons aujourd’hui sous le terme moins discriminant de santé mentale.
Or, il faut en convenir, la santé mentale ne rayonne pas de vitalité. Malgré les milliards qui y sont dépensés chaque année, les gens vont toujours plus mal. Depuis les années 2000, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare que la maladie mentale constitue la première cause d’invalidité dans le monde. Au préalable, cette invalidité résultait d’affections physiques telles que le cancer, les maladies infectieuses et cardiovasculaires. La dépression, le burnout, l’anxiété, ainsi que les centaines de troubles répertoriés depuis un demi-siècle par les manuels de diagnostics psychiatriques ne représentaient jadis pas une menace pour le fonctionnement de la société. Les fous, il y en a toujours eu. Qu’ils soient tolérés, exclus ou enchaînés, leur présence s’avérait plus ou moins sous contrôle. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Les coûts liés à la santé mentale explosent, plombent les ménages et minent les esprits d’une partie toujours plus conséquente de la population. Les jeunes sont dépressifs dit-on, le décrochage scolaire se propage, les vieux sont isolés, abandonnés et maltraités, quant à ceux qui sont censés produire et maintenir la marche du navire, ils ne perçoivent plus le sens de leurs activités. Ils sont empêtrés dans ce que David Graeber appelait des bullshit jobs. Conscients de l’absurdité de leurs tâches, ils se désinvestissent, tombent malades et se mettent en congé.
L’autre jour, je me suis retrouvée dans l’open space d’un quotidien romand qui était quasiment désert. Lorsque je me suis renseignée sur l’origine de ce vide, on m’a répondu qu’une formation sur le burnout était en train d’être divulguée dans la pièce d’à côté. J’ignorais que ce trouble de l’auto-exploitation bénéficiait d’une promotion à part entière. Le certificat médical qui atteste l’inhabilité d’un individu à se rendre au travail pour burnout bénéficie, découvris-je également, de la même valeur légale que le certificat médical octroyé à celui qui subit une transplantation cardiaque ou qui réside, entubé et dans le coma, aux soins intensifs. Je ne nie pas que l’industrie du travail peut s’avérer, selon les conditions, hostile, voire toxique au bien-être de chacun. Je ne nie pas non plus que le monde va mal et que les perspectives ne sont plus ce qu’elles étaient. Ce que je questionne, c’est la place de la médecine dans cette affaire. Qu’a-t-elle à dire? Son hubris ne découlerait-elle pas justement de son obstination à vouloir diriger un domaine qu’elle ne peut, à elle seule, maîtriser, à savoir celui des affres de l’âme?
Si nous nous penchons deux minutes sur l’histoire de la psychologie, on constate qu’avant le 19e siècle, son étude se situait au croisement de la philosophie, de la religion et de la médecine. Ce n’est qu’à partir de la fin du 20e siècle qu’elle a muté vers une discipline dite scientifique. Une campagne ardente fut menée pour la destituer de ses composantes mystiques et pour la ramener à des causalités d’ordre physique. C’est d’ailleurs en partie pour échapper au pouvoir clérical que la psychologie mena une cour invétérée auprès des sciences médicales. Aussitôt légitimée par elles, la psychologie devenue psychiatrie s’entêta à calquer ses méthodes sur celles de la recherche somatique. Freud, qui passe lui aussi un mauvais quart d’heure (alors que son acolyte Jung est en pleine réhabilitation), était obsédé par la composante scientifique de ses théories. Après lui, d’autres se sont tués à scientifiser leurs observations. En vain, les psychiatres ont cherché la fameuse lésion cérébrale qui serait à l’origine de la folie, ils ont expérimenté la lobotomie, les électrochocs, l’insulinothérapie, puis les psychotropes. Ces tentatives de scientifisation ou de matérialisation de l’âme, qu’elles furent ou non réalisées avec de bonnes intentions, se sont dans la majorité des cas soldées par des échecs. Le paradigme biochimique de la psychiatrie dans lequel nous placions encore récemment tous nos espoirs s’est lui aussi pris un mur. Car non, il ne suffit pas de stimuler un neurotransmetteur par-ci et d’en endormir un autre par-là pour que le sens de la vie se rétablisse. Un nombre croissant d’études démontrent l’efficacité limitée des psychothérapies et des pharmacothérapies et, plus je m’entretiens avec des psychiatres, plus je constate que les maux dont se plaignent leurs patients sont davantage liés à des paramètres socioéconomiques et spirituels que médicaux. Pourquoi continuons-nous donc de charger la médecine de responsabilités qui dépassent ses compétences ? Nulle prise de sang, scanner ou radio n’est apte à confirmer le diagnostic d’un burnout, d’un trouble du déficit de l’attention ou d’une dépression. Nous disposons de surcroît de peu d’expertise et de recul sur l’existence avérée de ces troubles.
«Pourquoi continuons-nous de charger la médecine de responsabilités qui dépassent ses compétences?»
En attendant, guérisseurs de l’âme, bioénergéticiens, médiums et chamanes en tous genres prolifèrent à chaque coin de rue. Nous prenons des psychédéliques, nous parlons à nos ancêtres, nous embrassons les arbres et nous méditons avec des mantras qui nous ont été transmis sous le sceau du secret. Le succès des guides spirituelles, sorcières, druides ou enchanteurs, appelez-les comme vous le voulez, traduit le besoin vital que nous avons de nous reconnecter, en ces temps de débâcle, à la partie magique, immatérielle et transcendantale de l’existence humaine. Je ne dis pas qu’il faille radier l’étude expérimentale des phénomènes de la psyché, loin de là. Il est tout à fait réjouissant que des études randomisées sur les bienfaits de la méditation en pleine conscience ou sur les vertus de la sylvothérapie soient menées et nous ne pouvons qu’espérer qu’elles se poursuivent. En revanche, léguer l’angoisse existentielle de l’humanité à la faculté de médecine me paraît absurde. Plus absurde encore que ceux qui, dans Harry Potter, dénient l’existence de la dimension magique de l’existence.
Autour de la table en vieux bois, acteurs et experts du monde médical conviennent de la nécessité d’accorder davantage d’importance à la prise en charge de la santé mentale. Des cellules de crise et des dispositifs doivent urgemment être mis en place. De nature timide, je n’ose les contredire. Je n’ose pas leur dire que je viens de trouver la solution à tous leurs problèmes: éjecter la psychiatrie des sciences médicales. Un petit coup de pied dans le postérieur et, hop, l’étanchéité du navire serait rétablie. L’orage s’interrompt. Un arc-en-ciel se dessine sur les cimes et le soleil se met à briller de mille feux. C’est à ce moment-là que l’idée de me lancer en politique me traverse l’esprit. Au lieu de promouvoir le burnout dans les lieux de travail de chacune et de chacun, je militerais pour la réhabilitation de la dîme, à savoir d’une taxe, d’un impôt ou d’une assurance sociale qui couvrirait les maux de l’âme. Le congé médical lié à ma détresse émotionnelle ou à mon besoin imminent d’effectuer un vipassana ou un jeûne de quarante jours en forêt serait distribué, non plus par mon médecin, mais par mon druide. Ce dernier, s’il souhaite disposer d’une quelconque autorité auprès de mon assurance spirituelle, devra répondre à des exigences de formation, d’expérience et ainsi de suite. Quant aux psychiatres, je ne les chasserais aucunement. Non, ils pourront continuer de vanter leurs savoir-faire qui seront, contrairement à ceux des druides et des sorcières, soutenus par une recherche expérimentale et dite laïque. On pourrait même, pourquoi pas, imaginer un label evidence-based médecine qui conférerait à ces pauvres médecins une sorte de statut supérieur et réconfortant dont se verraient privés leurs confrères, ces charlatans.
Si je dis ces pauvres médecins, c’est parce qu’ils ont sacrifié les meilleures années de leurs vies, le dos courbé sur un pupitre, à apprendre des fiches par cœur. Ils ont passé des examens, planté leurs mains dans le cambouis, ils se sont exercés au toucher rectal, ont accompagné de près la vie et la mort, et voilà qu’ils se retrouvent confrontés à une épidémie de thérapeutes non-médecins qui, après une petite année de formation continue, ouvrent des cabinets au centre-ville et affirment savoir soigner les origines de la mal à dit. Les uns sont broyés par une paperasse toujours plus conséquente qui empiète sur la qualité relationnelle qu’ils pourraient accorder à leurs patients, les autres décorent leurs cabinets de lampes de sel et de coussins moelleux et accueillent paisiblement tous les désillusionnés du système de santé traditionnel.
J’exagère un peu évidemment, mais ce que j’essaie de dire de manière peu diplomatique, c’est que les sciences médicales se battent contre le mauvais cheval. Elles s’obstinent à préserver le monopole d’un territoire, celui de l’âme, qui s’avère incompatible avec l’ère du temps. Pour préserver son empire, la reine d’Angleterre dut elle aussi se délester d’un bon nombre de ses colonies. Je pense donc que oui, l’heure est venue de décoloniser la médecine de cette tare qu’est la santé mentale et, en contrepartie, de réinstaurer la dîme afin que nous puissions tous librement prendre du LSD lors de la pleine lune, implorer dieux, déesses et animaux totem et, tenter, coûte que coûte, de réenchanter le sens que nous accordons à nos vies pourries. •
